PRÉSENTATION
Reuven Miran met en scène des fragments de vie exprimés par des rêveries, des fables, des anecdotes, des narrations, où les rencontres humaines, en tous lieux, le train, le bateau et l’avion, les hôtels, les cafés et les bars, et même les bordels de haute volée tiennent une grande place. Mais ici, l’émotion ne cède pas au sentimentalisme ou à la nostalgie, elle est nourrie d’intelligence, de réflexions sur le temps, l’espace, l’identité des personnages, leur moi… Haut en couleur.
« Ce livre propose plus que l’expérience de la saison singulière [la saison morte], plus que le contenu de la mémoire, il examine l’essence de la mémoire et de ses voies d’action, ses limites et sa force créatrice » ; « l’une des vertus marquantes de la saison morte elle-même est la disparition du moi aux limites connues ». (Shahar Bram, Université de Haïfa, Département de littérature hébraïque et comparée)
De la première à la dernière, ces nouvelles conquièrent immédiatement. Novelliste hors pair, Reuven Miran dépoussière totalement ce genre difficile, qu’il cultive en textes brefs, voire ultracourts. Ici, la nouvelle la plus ténue est faite d’une ligne et la plus longue comporte une quinzaine de pages. (Michel Garel, traducteur)
LE MOT DE L’ÉDITEUR
Mémoires d’une saison morte a été une découverte, au moment précis où les Éditions Lis & Parle envisageaient de créer une collection en littérature pour élargir ses champs du savoir et de la culture. Nous remercions chaleureusement notre ami et traducteur Michel Garel qui nous a proposé d’éditer ce recueil de nouvelles dont « la magie du style campe d’emblée, une ambiance, un milieu ou un climat en un minimum de phrases, soit, en quelques mots seulement, une atmosphère singulière et prenante – tour à tour poétique, politique, onirique, fantastique, sociale ou tout bonnement absurde […] où le déshérité a souvent sa place, qu’il soit arabe d’Israël ou des territoires, réfugié sud-soudanais, boy bantou, ou homme d’Afrique en général. Sans même parler des vieilles dames, des chiens écrasés, des femmes à la dérive et des couples qui se défont […] » (Michel Garel, traducteur).
Mémoires d’une saison morte est le premier livre de Reuven Miran traduit en français. Puissent les lecteurs et la critique littéraire reconnaitre le talent de cet écrivain qui a reçu de nombreux prix dans le monde pour l’ensemble de son œuvre, d’autant plus que nous bénéficions d’une élégante et remarquable traduction dans la langue de Molière.
PRESSE / MÉDIAS / RECENSIONS
- Postface de la version en hébreu de Mémoires d’une saison morte, par Shahar Bram (Université de Haïfa, Département de littérature hébraïque et comparée), traduite par Michel Garel.
L’espace vide à l’entour des mots
Elle ne se pose jamais, la mémoire, et pas plus pendant les saisons mortes. Elle poursuit dans les profondeurs son petit bonhomme de chemin, elle recueille, amasse et conserve, et, un jour, quelque part dans l’avenir, les notes sauvegardées surgiront à la vie, par la main du hasard qui les réveillera ou d’une autre, plus calculée, qui les dégourdira : pour l’écrivain, les saisons mortes sont aussi une source de vie, et en conséquence, il faut y creuser, déplacer pierres et rocs, et lui frayer un chemin au moment même où elle tente de trouver son cours au-dehors, afin de jaillir en mots et de remplir la surface de la page vide. Les espaces blancs qui font émerger les archipels des souvenirs sont une part inséparable de ce livre. L’espace vide qui entoure les mots est l’espace de la mémoire, le témoignage de ce qu’il est impossible de faire vivre de nouveau, la représentation des territoires morts du domaine intérieur et de ce qui y est gardé, enterré dans les profondeurs, ou peut-être même déjà rayé et qui n’est plus. De cet espace-là, où flottent néanmoins ces îles-ci, les mots, en jaillissant, ont investi le lieu sur la surface blanche. Ces mots-là attestent non seulement que la conservation de la mémoire est possible, mais qu’ils sont aussi les témoins de sa force créatrice, car ce livre ne propose pas un voyage dans le passé, mais fait voyager le passé dans le présent : fractures et éclats ont droit à une vie à eux, une vie indépendante qui ne saurait être asservie au « moi » de son for intérieur. Ce livre donne vie aux matériaux de la mémoire sans les subordonner à un maître, une sorte de « moi » ou de « sujet » qui digère tous les matériaux pour se raconter soi-même et asseoir son existence sur une entité unifiée et conséquente. Au lieu de la convention narrative bien connue qui pose le récit comme il se doit et d’un « moi » solide et entier ; au lieu d’une histoire convenue à la première personne et d’un « moi » pérenne dans ses changements, construite comme un flux temporel et causal qui va du passé au présent en promettant un avenir au « moi » – au lieu de tout cela, le livre nous propose des figures de remplacement et des visages qui changent. Les souvenirs ne se joignent pas l’un à l’autre pour créer une unité d’intrigue qui n’est jamais autre chose que l’unité de ce « moi-patron » conquérant ses composants et auto définissant pour lui-même son identité. Les souvenirs montent en scène comme des bouts séparés qui se transmettent par des voies différentes, narratives ou autres (rêveries, anecdotes, fables) ; les souvenirs montent comme des fragments qui ne vont pas nécessairement l’un avec l’autre : parfois ce sont des fractures qui témoignent de l’entièreté disparue, parfois le fragment accouche d’une histoire qui met à mal le cadre du passé, parfois les fragments ont des liens communs, parfois ils n’ont absolument pas de relation entre eux. La mémoire n’est pas seulement un silo d’emmagasinement, elle n’est pas seulement susceptible de recroquevillement ou d’hibernation, elle est capable également de création et de remodelage à neuf. Les souvenirs font irruption et se proposent eux-mêmes au nom du droit d’eux-mêmes, et non à celui du « moi » où ils sont reclus, la mémoire se libère des entraves de l’amertume du « moi » unitaire et dominant. En résulte-t-il pour autant un rien de grande liberté ?
Bien que l’on n’ait pas dit un mot sur la nature de la saison morte, on a déjà dit une ou deux choses sur le chemin qu’elle prend pour se lever à la vie. Plutôt que de revenir en arrière sur le processus, je souhaiterais tourner l’attention du lecteur vers les voies de son ordonnancement. Ce livre propose plus que l’expérience heureuse de la saison singulière, plus que le contenu de la mémoire, il examine l’essence de la mémoire et de ses voies d’action, ses limites et sa force créatrice. Aussi, de toute évidence, il pose des questions sur le cheminement légitime du récit, sur la poétique adéquate d’utilisation des matériaux et sur l’agencement de la mémoire, la conscience et le « moi » en général. Le titre de l’ouvrage, Mémoires d’une saison morte, aiguille l’attention du lecteur vers une relation entre les souvenirs nombreux et une saison unique : comment donc la multiplicité et la palette des souvenirs bâtissent-elles une saison, singulière et différente ? Comment appeler l’entier nuancier des souvenirs de quelque chose d’unique, quand les personnages, les lieux et les temporalités varient, alors même que tous ces souvenirs-là n’ont pas de « maître de maison », de « moi » solide doté d’une identité définie ? Quand il n’y a pas un récit, mais des histoires nombreuses, et quand, en lieu et place d’une intrigue, il y a fractures, rêveries et fables, dont le lien entre elles n’est pas clair ? Tout cela se fond-il en une chose unique, et si oui, selon quel principe ? Est-ce que, au lieu de penser à un roman de souvenirs ou à un récit de vie en termes d’unité, de rationalité, de cohérence et de causalité, n’est-il pas légitime désormais que nous pensions la chose en termes de globalité, de « fragmentarité », d’instabilité, de liens de réciprocité associative et de moules de large étendue ? Peut-être vaut-il la peine de penser cette chose unique comme la bobine confuse d’un film où les rouleaux de pellicule sont déchirés et s’entremêlent les uns aux autres ? Peut-être ainsi est-il vraiment possible d’imaginer tout ce monde intérieur : comme un méli-mélo de film et de bande-son, qui déchirée, qui rayée, dont il est impossible de voir et d’écouter le récit de manière linéaire cohérente, mais dont on peut capter des extraits de la bobine et entendre la multiplicité des bruits que nous amassons en nous. Toute l’histoire est dans cette bobine et le livre demande comment le raconter, un livre qui pose des questions sur la mémoire, sur la façon dont nous l’utilisons, sur la manière dont nous préférons pour la relater (la mémoire, avec l’aide de la mémoire), et sur le prix à payer : si la mémoire, ou le « moi » en général, est une globalité de composants au sein de l’étendue intérieure, dont le lien entre eux n’est pas toujours défini, qu’avons-nous à gagner et qu’avons-nous à perdre si nous préférons les agencer conformément au moule traditionnel du « moi » en suivant un schéma d’intrigue connu ? La création d’une entité constante dans le temps, en dépit des circonstances et des aléas, est-elle un gain ou une perte pour ce qui est de la multiplicité et de la palette ?
À revenir maintenant à l’examen de la très brève discussion que j’ai faite concernant le déroulé de la narration, on constate que ce qui s’est dit est caractéristique du processus. Le lecteur qui a terminé le livre aura évidemment perçu que l’une des vertus marquantes de la saison morte elle-même est la disparition du « moi » aux limites connues : dans les différents souvenirs montent en scène des espions déguisés, des commis aux identités d’emprunt, des étrangers dont le passé n’est pas connu, sinon d’eux-mêmes, des personnages sans nom dont l’identité peut être douteuse et nauséabonde. Entre les histoires que la mémoire perd ou invente, ou celles dont la relation directe est faite de la bouche d’un « moi » narrateur de la saison morte, l’étrangeté du « moi » à lui-même revient ici sans cesse. Le flou des identités, les changements de visage, le gommage des traits reconnaissables et leur mutation en d’autres, les avatars du « moi » en « moi » – tout cela est représentatif de l’expérience de la vie pendant la saison morte. Cette mort dont il est question, cette saison morte va même jusqu’à conter la mort du thème de l’examen d’une identité stable et définie – et c’est là ce que j’ai pointé du doigt plus haut. La question qui concerne la multiplicité dans l’unité et l’unité de la multiplicité a un effet sur le contenu de la mémoire, à savoir sur ce qui caractérise l’expérience de la vie pendant la saison morte, tout autant que sur la structure de la mémoire et de son fonctionnement : récit et histoire s’unifieraient, forme et contenu feraient un, l’identité établissant quelque relation entre les deux. Une tentative pour imbriquer les souvenirs à l’ensemble de la construction narrative ne va pas les faire s’accorder à l’essence de l’expérience de vie représentative de la saison morte : dans ce chapitre de vie, le « moi » n’est pas un, il perd son identité, il est mort et enfoui dans d’autres identités, ondoyant et divers, selon les circonstances, les fonctions et les limites spatio-temporelles qui changent. Si le mot loyauté a quelque sens en relation avec le fait même de la création littéraire, c’est bien ici qu’il s’exprime : tresser les matériaux de la saison morte à un « moi » sûr et solide, une sorte de moi dont les saisons peuvent être bonnes ou mauvaises, mais de toute manière qui se reconnaît lui-même, bâtir à neuf un « moi » en tant que flux linéaire causal marchant de façon chronologique vers l’avenir d’un pas assuré – serait en ce cas faire œuvre de mensonge. Les espaces intérieurs, l’hétérogénéité et la déchirure sont une part de l’identité. Disons-le en d’autres termes : la saison morte ne nous apprend-elle pas quelque chose sur l’essence des saisons, bonnes et mauvaises, et le « moi » à l’identité stable et connue ?
J’espère que ces brefs propos expliquent pourquoi ce livre sort au jour dans une nouvelle édition. Quand il parut en 1996, avant que la très courte nouvelle ne devienne ici un genre courant et familier, ce livre proposait déjà beaucoup plus qu’un recueil de brèves nouvelles. Sur la qualité de Miran comme écrivain, on ne s’appesantira pas : il vogue à merveille sur l’enveloppe fragile de l’expérience émotionnelle sans tomber dans le piège du cliché, l’abîme du sentimentalisme ou le territoire sûr de la nostalgie. L’expérience émotionnelle n’est pas coupée de l’expérience intellectuelle. Et de là, en fait, mes propos exprimés plus haut. Mais, comme déjà dit, ce livre propose plus encore, et il est clairement à part de la plupart des recueils de très courtes nouvelles venus après lui : la relation entre le tout et ses parties est une chose qui coupe le souffle dans ce livre, qualité que sent tout lecteur, qui perçoit que ces histoires, ces souvenirs bâtissent, quelle qu’en soit la voie, un monde, une saison particulière, qu’il est difficile de définir, mais qu’on peut identifier immédiatement. Dans cette nouvelle édition, j’ai tenté de mettre l’accent sur cette dimension et d’affûter les qualités narratives remarquables de Miran : de même qu’il ne cherche pas l’occasion d’estampiller de surprise les paragraphes des mémoires, ainsi ne s’obstine-t-il pas à bâtir un roman du souvenir imaginaire à la mesure d’un « moi » selon la règle. Et c’est justement pour cela que ces mémoires vivent et respirent et que la saison morte a une qualité qui la distingue de toute autre saison.
DÉTAILS
ISBN : 978-2-915387-14-8
Éditeur : Éditions Lis & Parle
Date de publication : 2025
Nombre de pages : 128
Format : 105 x 170 mm




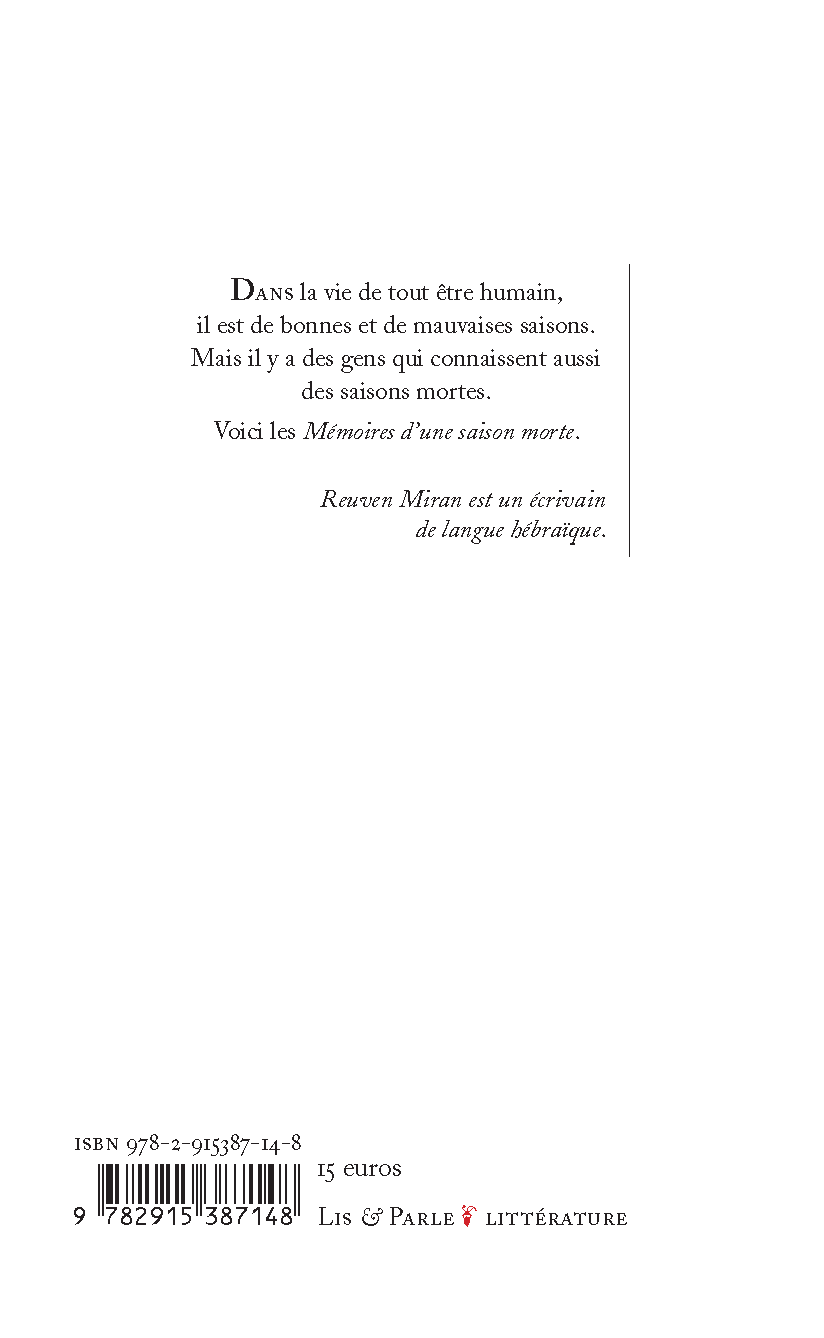



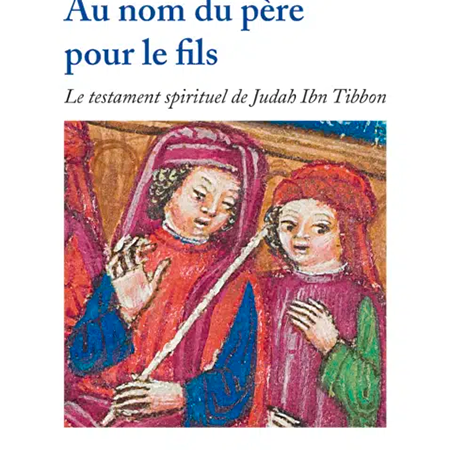
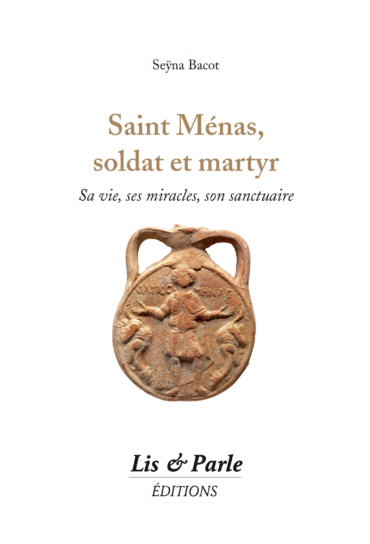

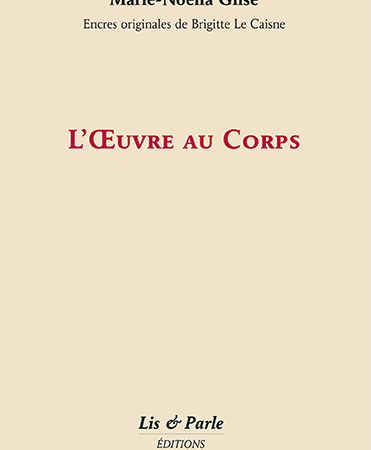
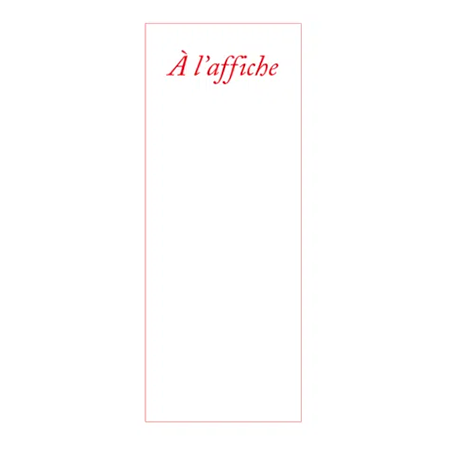


Avis
Il n’y a pas encore d’avis.