« Celui qui dure ». « Saint Ménas, soldat et martyr ». Un livre de Seÿna Bacot, postface de Christian Cannuyer.
L’Église des trois premiers siècles chrétiens est une église des martyrs. À Rome, en Gaule, en Asie mineure, en Égypte, les passions des martyrs font mémoire de ces hommes et de ces femmes de tous âges et de toutes conditions sociales, ces « athlètes de Dieu » tenant tête avec assurance à leurs juges, endurant avec fermeté les supplices les plus variés et méritant ainsi la couronne immortelle. Les textes qui leur sont consacrés, éloges de leur vie, récits de leurs miracles, homélies, prières liturgiques, soulignent que le martyre est un baptême de sang, plus noble encore que le baptême d’eau, et que les saints martyrs surpassent en gloire tous les autres saints.
Le présent ouvrage est consacré à la vie et aux miracles d’un des saints les plus honorés de l’Égypte, saint Ménas. Ce soldat de noble naissance fut martyrisé en Phrygie lors des persécutions ordonnées par l’empereur Dioclétien et ses successeurs. C’était le 11 novembre 309, selon une antique tradition égyptienne. Son tombeau attira rapidement les pèlerins en foule, les miracles s’y succédèrent. Le modeste édifice, dit martyrion, construit sur le lieu même de son martyr, fut vite agrandi, entouré de basiliques, de monastères et de toute une ville, Abu Mina, avec hôtelleries, marchés et hospices pour accueillir les pèlerins. Les fouilles archéologiques des XXe et XXIe siècles ont rendu à la vie ces nombreux édifices. Par ailleurs, quatre manuscrits en langue copte sahidique, à l’écriture et aux ornements soignés nous ont transmis les détails de sa vie et de ses miracles.
Le culte de saint Ménas se répandit rapidement à travers l’Égypte. De nos jours encore, les pèlerins peuvent se rendre à Abu Mina et vénérer le saint martyr dans le monastère actuel, érigé en 1959 par le patriarche Cyrille VI. Ce site est inscrit au patrimoine mondial de l’Unesco. Nous savons que le culte du saint se répandit bien au-delà des frontières de l’Égypte, et jusqu’en Gaule. Deux églises de la Drôme et de la Haute-Garonne possèdent toujours vitraux et statues représentant le martyr. Les fameuses ampoules à eulogie que nous pouvons admirer dans nos musées sont les témoins de l’universalité de ce culte. Ces modestes gourdes de terre cuite représentaient saint Ménas entouré de deux chameaux, faisant ainsi mémoire de son séjour en ermite au désert. Les pèlerins y recueillaient un peu de l’huile des lampes qui illuminaient jour et nuit la tombe du saint. Ils les rapportaient dans leur lointain pays et contribuaient ainsi à la diffusion de son culte.
Ce livre réunit douze des miracles de saint Ménas. Dix d’entre eux sont présentés pour la première fois dans leur traduction française. Une introduction à ces textes permet de les replacer dans leur contexte géographique, historique, artistique. Elle voudrait faire apprécier au lecteur la vivacité des descriptions, la saveur des dialogues, et la profondeur du sentiment religieux des pèlerins de cette époque. Elle tente enfin de souligner l’importance du culte des martyrs dans l’Égypte des premiers siècles.
Seÿna Bacot
Postface par Christian Cannuyer
Il est fascinant de penser que le nom de saint Ménas, porté par tant de coptes aujourd’hui sous la forme Mina, remonte aux premiers temps de la culture pharaonique. Il correspond en effet sans aucun doute à l’égyptien ancien Méni*, qui, dans la liste dressée par le pharaon Séthi Ier (XIIIe siècle av. J.-C.) sur un mur du temple Abydos, ainsi que, peu après, dans le catalogue du Canon royal de Turin, n’est autre que le nom du premier roi plus ou moins mythique d’Égypte, transcrit « Mîn » par l’historien grec Hérodote au Ve siècle av. J.-C. (Histoire II, 99), « Ménès » par le prêtre égyptien Manéthon au IIIe siècle av. J.-C., et « Ménas » par Diodore de Sicile, au Ier siècle av. J.-C. (Bibliothèque historique, I.2, 45). Son étymologie est l’objet de plusieurs hypothèses, dont la plus plausible me semble celle qui le rattache au verbe mn, « durer ». Ménas signifierait « Celui qui dure ».
Mina fut aussi le nom monastique porté par le futur pape Cyrille VI (1902-1971) avant qu’il ne fût élu successeur de saint Marc à la tête de l’Église copte en 1959. Ce pontife hautement charismatique et très aimé des chrétiens égyptiens avait une dévotion toute particulière pour saint Ménas, dont il vénérait sou- vent les reliques dans l’église du quartier de Fom al-Khalig au Caire, où elles avaient été transférées au temps du patriarche Benjamin II (1327-1339), après que le sanctuaire de Maréotide eut été progressivement abandonné. Devenu cent seizième pape et patriarche d’Alexandrie, Cyrille VI ordonna immédiatement la construction d’un nouveau monastère à proximité des ruines du martyrion du saint dégagées par Carl Maria Kaufmann à Karm Abu Mina. Le 15 février 1962, les reliques de Ménas y furent solennellement retranslatées, alors que Peter Grossmann venait de reprendre les fouilles de l’antique complexe. Depuis 1972, Cyrille VI repose dans une crypte sous l’autel majeur de la nouvelle et somptueuse basilique. Grâce à lui, le culte de saint Ménas et le pèlerinage en Maréotide ont retrouvé vigueur.
Cyrille VI, vénéré par les Coptes comme l’un des grands saints de l’époque contemporaine, a été le refondateur du monachisme égyptien et même de l’Église copte, qui lui doit largement son dynamisme actuel. Qu’il ait, pendant sa vie monastique, porté le nom de Mina, non seulement celui du saint martyr mais aussi du roi fondateur de la monarchie pharaonique – dont, dans l’antiquité tardive, le patriarche d’Alexandrie a parfois été considéré comme une sorte d’héritier –, illustre l’étonnante permanence, en Égypte, d’une longue mémoire collective, qu’elle soit consciente ou non… J’ai pu suggérer par ailleurs** que l’iconographie de saint Ménas le montrant entre deux chameaux était à mettre en relation avec celle de stèles magiques pharaoniques bien connues où le dieu Horus se tient entre des bêtes dangereuses, traduction égyptienne du vieux thème oriental du « maître des animaux ». Or, des blocs remployés d’un monument pharaonique ont été retrouvés dans les murs de la première phase de construction du baptistère de Karm Abu Mina, qui pourrait, d’après ce que m’a confié Peter Grossmann en 1999, avoir appartenu à un sanctuaire d’Horus…
En sorte que ce superbe petit livre de Seÿna Bacot présente un intérêt à la fois historique et très actuel. La dévotion envers saint Mina aujourd’hui de nouveau très vivante s’enracine à la fois dans les origines du christianisme égyptien et dans des traditions onomastiques et symboliques de l’Égypte pharaonique. Comme quoi le temps, en Égypte, ne cesse de donner de l’étoffe à l’être. Et Ménas est vraiment « Celui qui dure »…
Notes :
*
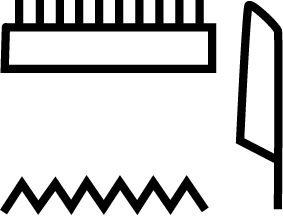
** Christian Cannuyer, « Saint Mina aux chameaux : autour des origines d’un iconotype copte », Le monde copte 27-28, Limoges, 1997, p. 139-154. Voir aussi David Frankfurter, « The Binding of Antilopes : a Coptic Frieze and its Egyptian Religious Context », JNES 63, Chicago, 2004, p. 97-109.






Leave a Reply
Want to join the discussion?Feel free to contribute!